Nos projets
Cette page est en cours de réalisation. Revenez bientôt pour découvrir son contenu !

Cet axe de recherche porte sur les processus affectifs impliqués dans les troubles psychiatriques et addictologiques.
Notre objectif est de formuler et de tester de nouvelles hypothèses sur la manière dont les dysfonctionnements affectifs contribuent au développement et au maintien de ces pathologies, de mieux caractériser les profils de patients et de proposer des solutions innovantes en termes de prévention et de traitements.
Nos travaux se concentrent particulièrement sur les troubles liés au stress et au trauma, sur la dépression ainsi que sur l’addiction à l’alcool.
Pour ce faire, nous allions des méthodes de psychologie expérimentale et d’évaluation clinique à des approches en neurosciences (oculométrie, électroencéphalographie, neurophysiologie) et en intelligence artificielle, afin de décrypter plus finement les mécanismes affectifs sous-jacents et d’optimiser les prises en charge.
Biais attentionnel et trajectoires post-traumatiques
Projet porté par Arnaud Bugnet (doctorant) & Fabien D'Hondt
Ce projet repose sur l’hypothèse que les biais attentionnels envers les stimuli négatifs peuvent précéder le développement du TSPT. Des études antérieures menées par notre équipe (Veerapa et al., 2023) ont mis en évidence un biais de maintien attentionnel vers les informations négatives chez les personnes atteintes de TSPT, non directement attribuable à l’exposition traumatique elle-même. Nous développons actuellement un protocole d’évaluation en ligne basé sur l’oculométrie via webcam, permettant de suivre longitudinalement des individus récemment exposés à un traumatisme. L’objectif est de déterminer si ce biais est déjà présent dans la période péritraumatique, et s’il peut être utilisé comme indicateur précoce de vulnérabilité, ouvrant ainsi la voie à des stratégies de prévention ciblées fondées sur les mécanismes cognitifs précoces du TSPT.
Contact : arnaud.bugnet@chu-lille.fr; fabien.d-hondt@univ-lille.fr
Rééducation attentionnelle adjuvante à la thérapie d’exposition
Projet porté par Arnaud Bugnet, Guillaume Vaiva & Fabien D'Hondt
Ce projet vise à évaluer l’efficacité d’un nouveau protocole de Attention Control Training (ACT) assisté par eye-tracking, spécifiquement conçu pour cibler le biais attentionnel observé dans le TSPT. Contrairement aux tentatives antérieures peu concluantes, notre méthode s’appuie sur un système de rétroaction en temps réel qui bloque le maintien de l’attention sur les images négatives en inversant leur position dès que la fixation oculaire excède un certain seuil. Ce mécanisme d’interruption du biais attentionnel pourrait renforcer les effets des thérapies d’exposition prolongée et réduire significativement les symptômes persistants d’hyperactivation.
Contact : arnaud.bugnet@chu-lille.fr; fabien.d-hondt@univ-lille.fr
HYPE
Projet porté par Wivine Blekic & Fabien D'Hondt
Le projet HYPE a pour objectif d’explorer les mécanismes cognitifs et neurobiologiques sous-jacents aux symptômes d’hyperactivation dans le trouble de stress post-traumatique (TSPT) en intégrant des approches issues des neurosciences, de la psychologie et du machine learning. Il repose sur trois axes de recherche principaux :
1. Évaluer les processus cognitifs impliqués dans l’hyperactivation : L’étude vise à mieux caractériser les symptômes d’hyperactivation (hypervigilance, réponse de sursaut, irritabilité, troubles du sommeil et de la concentration) en combinant des mesures comportementales, électrophysiologiques (EEG) et oculométriques (eye-tracking). Cette approche permettra d’identifier les biais cognitifs spécifiques associés à l’hyperactivation chez les patients atteints de TSPT.
2. Examiner l’impact du genre et des antécédents traumatiques : Certaines études suggèrent que le genre et les expériences traumatiques passées influencent le développement du TSPT via des mécanismes spécifiques d’hyperactivation. Le projet étudiera ces interactions en recrutant des patients récemment exposés à un traumatisme et en les comparant à des individus non-exposés et à des personnes ayant vécu un trauma sans développer de TSPT.
3. Utiliser le machine learning pour prédire la trajectoire du TSPT : Grâce à des techniques de machine learning, l’objectif est d’identifier les facteurs prédictifs de la sévérité et de l’évolution du TSPT en se basant sur les données longitudinales collectées. Cette approche permettra de dégager des marqueurs cliniques exploitables pour améliorer le dépistage et le traitement des patients à risque.
Ce projet repose sur une méthodologie innovante, incluant une évaluation longitudinale des patients à différentes étapes après leur exposition à un traumatisme (1 mois, 3 mois, 6 mois). Il s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire en associant psychologie cognitive, neurosciences affectives et psychiatrie computationnelle, avec pour ambition de mieux comprendre l’hyperactivation et d’améliorer les interventions thérapeutiques destinées aux patients atteints de PTSD.
Contact : wivine.blekic@inserm.fr; fabien.d-hondt@univ-lille.fr

CALYPSO
Le projet Clinique et AnaLYses PSychiatriques Objectives (CALYPSO) ambitionne d’identifier des marqueurs cliniques objectifs pour les troubles psychiatriques, afin d’améliorer la précision des diagnostics, de mieux anticiper le pronostic et la réponse aux traitements, et d’ouvrir ainsi la voie à des interventions plus adaptées aux profils individuels.
L’ampleur des troubles visés par CALYPSO en quelques chiffres…
300 millions : Nombre de personnes affectées par la dépression dans le monde
70 % : Proportion des individus exposés à des événements potentiellement traumatiques au cours de leur vie
24 % : Prévalence du trouble de stress post-traumatique (TSPT) suite à un événement traumatique
CALYPSO : Vers une psychiatrie de précision
Les troubles psychiatriques touchent aujourd’hui près d’une personne sur huit dans le monde, faisant de la santé mentale un enjeu majeur de santé publique. Cette situation s’intensifie face aux crises globales comme la pandémie de COVID-19 et les bouleversements climatiques, qui amplifient des pathologies telles que la dépression et le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Bien que la recherche en psychiatrie ait permis des avancées significatives, les mécanismes sous-jacents à ces troubles demeurent encore peu voire pas connus, et les découvertes peinent souvent à se traduire dans la pratique clinique. L’un des défis majeurs réside dans la reproductibilité des résultats scientifiques, largement affectée par une hétérogénéité des troubles encore mal appréhendée par les classifications actuelles. Nous pensons qu’enrichir la définition des troubles psychiatriques grâce à des marqueurs objectifs, rendus possibles par les technologies d’intelligence artificielle et de vision par ordinateur, pourrait transformer cette approche. En permettant d’étudier des groupes de patients plus homogènes, ces avancées offriraient une voie vers des traitements plus ciblés et un pronostic amélioré, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.
Les troubles somatiques fonctionnels (TSF)
Projet porté par Mathilde Horn & Louise Loisel-Fleuriot
Les troubles somatiques fonctionnels (TSF) sont caractérisés par la présence de symptômes physiques persistants dont l'intensité contraste avec l'absence d'anomalie clinique ou paraclinique pouvant en expliquer la cause de manière complète.
Ces troubles, bien que fréquents, restent mal connus et peu compris, ce qui conduit à un sous-diagnostic, une stigmatisation des personnes qui en souffrent et une offre de soins limitée.
Nos travaux ont ainsi pour objectif d'améliorer la compréhension de ces troubles.
Du point de vue épidémiologique, nos recherches se concentrent sur la description des individus atteints de TSF, l'identification de leur parcours de soins et les répercussions sur leur vie personnelle, professionnelle et sociale.
Sur le plan physiopathologique, l'objectif est de comprendre les mécanismes cognitifs sous-tendant l'émergence de ces troubles.
Nos recherches s'inscrivent dans le cadre des soins cliniques dispensés à ces patients, avec pour finalité l'adaptation des traitements proposés. Dans cette perspective, nous élaborons des protocoles thérapeutiques, dont l'efficacité est par la suite évaluée, en nous attachant à identifier les facteurs prédictifs d'une réponse favorable.
Contact : horn.mathilde@gmail.com
Comprendre la catatonie : du symptôme à la prédiction thérapeutique
Projet porté par Ali Amad, incluant la thèse de Tomas Mastellari
La catatonie est un syndrome psychomoteur grave, encore trop souvent sous-diagnostiqué, qui peut survenir dans des contextes très variés : troubles psychiatriques (troubles de l’humeur, schizophrénie, psychoses post-partum, autisme), maladies neurologiques, inflammatoires ou infectieuses. Ses manifestations sont diverses : stupeur, mutisme, agitation, postures figées ou mouvements répétitifs, pouvant aller jusqu’à des complications vitales.
Notre équipe développe une approche globale et multidisciplinaire pour mieux comprendre ce syndrome complexe, à travers plusieurs axes de recherche complémentaires :
- Des études épidémiologiques, pour mieux cerner la fréquence, les causes et les conséquences (notamment la mortalité) de la catatonie.
- Des analyses cliniques et de réseaux de symptômes, pour affiner la structure nosographique du syndrome et mieux identifier ses sous-types.
- Des travaux en neuroimagerie (IRM, TEP au 18FDG), pour cartographier les anomalies cérébrales associées à la catatonie.
- Des études en pharmacogénétique et pharmacocinétique, visant à comprendre les facteurs biologiques influençant la réponse aux traitements.
- Des projets de génétique, incluant l’analyse d’exomes chez les patients catatoniques.
- Des approches computationnelles (IA et machine learning), pour modéliser la réponse aux traitements à partir de données cliniques et biologiques.
Au sein de cet ensemble, le projet PHARMAPREDICAT se concentre plus spécifiquement sur la prédiction de la réponse thérapeutique à la benzodiazépine, traitement de première ligne, en combinant neuroimagerie, pharmacologie et intelligence artificielle.
L’objectif global est de mieux comprendre les causes de la catatonie, ses mécanismes de résistance aux traitements, et de poser les bases d’une médecine de précision, adaptée à chaque patient.
Contact : ali.amad@chu-lille.fr
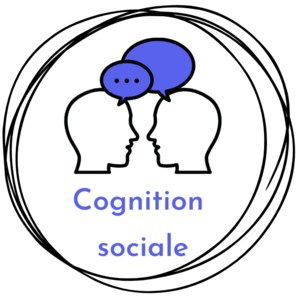
Cet axe de recherche vise à faire progresser l'évaluation des processus cognitifs sociaux.
Notre objectif est de développer de nouveaux marqueurs diagnostiques pour les troubles neurodégénératifs et psychiatriques tardifs, mais aussi d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui sous-tendent le comportement social et la communication.
Cognition visuelle
Projet porté par Muriel Boucart et Quentin Lenoble
Nous développons des recherches en neuroscience comportementale visant à la compréhension des mécanismes neurophysiologiques et cognitifs sous tendant les pathologies neuro-ophtalmiques (glaucome, Leber) et/ou neuro-visuelles comme dans la Sclérose en plaques.
Nos recherches sont organisées autour de deux axes :
- Les mécanismes sous tendant les déficits des fonctions de la vision centrale dans la reconnaissance des visages, des expressions faciales et des objets et la répercussion de ces déficits sur la cognition sociale.
- La compréhension de performances de type« perception-action » en lien avec la cognition spatiale (attention visuelle, détection, capacité d’orientation, utilisation d’outils numériques) chez des patients atteints de déficiences visuelles et dans le vieillissement normal.
Nous utilisons des outils tels que l’oculomètre, l’EEG, l’IRM.
Contacts : muriel.boucart@chu-lille.fr & quentin.lenoble@univ-lille.fr
CLAPP : CLassification des Aphasies Primaires Progressives
Remettant en question la distinction artificielle entre cognition sociale et langage, nous avons lancé le projet CLAPP, qui vise à mieux caractériser les profils langagiers dans des maladies neurodégénératives à expression cognitive prédominante, telles que la variante comportementale de la DFT (bvFTD), la maladie d’Alzheimer (MA) et les aphasies primaires progressives (APP), incluant les formes sémantique, non fluente, logopénique et anarthrique.
En collaboration avec les CMRR de Lille et de Toulouse, nous analysons rétrospectivement les performances de plus de 160 patients à l’aide d’une batterie standardisée d’évaluation du langage. Il s’agit de la plus grande cohorte francophone de patients atteints d’APP, et de l’une des plus importantes à l’échelle mondiale.
Nous appliquons des techniques de classification non supervisée et d’apprentissage machine pour identifier de nouveaux profils langagiers. Ces travaux devraient enrichir les classifications cliniques actuelles et affiner notre compréhension des relations entre symptômes cognitifs. Des investigations en neuroimagerie sont également en cours.
Parallèlement, nous étudions l’évolution des troubles du langage au cours du temps chez les patients APP, afin d’identifier des marqueurs pronostiques et d’adapter au mieux les prises en charge thérapeutiques. Ces projets de recherche constitue le cœur du travail de thèse d’Aurore Mahut-Dubos.
DIVA : Dominance, Intensity and Valence Assessment
Le langage parlé permet de communiquer explicitement ou implicitement nos états émotionnels. La prosodie, variation des tonalités de la voix, permet notamment cette transmission.
La mesure de la prosodie représente un intérêt clinique puisqu’elle peut être relativement automatisée ou intégrée à des plateformes de télémédecine ou de télépsychologie. De nos jours, des modèles d’Intelligence Artificielle permettent d’identifier automatiquement des dimensions affectives dans la voix : la dominance (sentiment de contrôle), l’intensité (la force de l’affect) ou la valence (son caractère plaisant ou déplaisant). Mais ces modèles ont été entraînés en majorité sur des données anglophones, et il n’existe aucun modèle ajusté sur des données francophones non québécoises.
Il est pourtant primordial, compte tenu des différences linguistiques et culturelles, d’adapter les modèles d’IA aux populations concernées. L’objectif de DIVA est de collecter les scores moyens de valence, d'arousal et de dominance sur un corpus audio francophone non québécois (GEMEP), auprès d'une population générale de personnes âgées de plus de 18 ans, afin d’affiner sur la population française un modèle de machine learning déjà entraîné, destiné à la reconnaissance émotionnelle d’enregistrements vocaux. Cette étude, conduite par Agnès Denève, permettra l’utilisation de modèle d’IA pour la reconnaissance des affects en pratique clinique.
Mini-SEA : Social cognition & Emotional Assessment
Au cours des vingt dernières années, des tests cliniques évaluant la cognition sociale et le traitement émotionnel se sont développés, notamment sous l’impulsion de nos travaux, devenant essentiels pour affiner les diagnostics différentiels entre maladies neuro-évolutives. Nous avons notamment montré que la cognition sociale permettait une distinction meilleure entre maladie d’Alzheimer (MA) et dégénérescence frontotemporale (DFT), par rapport à l’évaluation de la mémoire par exemple (Bertoux et al., 2018, 2020).
Si l’ensemble des études se sont davantage attachées à étudier la performance en cognition sociale dans les maladies neuro-évolutives à expression comportementale ou cognitive, jusqu’à récemment, peu d’études s’étaient intéressées à sa préservation dans des formes motrices comme la paralysie supranucléaire progressive (PSP) ou la maladie de Parkinson. En comparant la MA, la variante comportementale de la DFT (bvDFT), la PSP et Parkinson, nous avons identifié des déficits importants en mentalisation et reconnaissance des émotions dans la PSP, associés à une atrophie des régions frontales, cingulaires, insulaires et limbiques (Bertoux, de Souza et al., 2022). Ces travaux ont été conduit en collaboration avec plusieurs équipes d’Amérique Latine.
Les performances en cognition sociale distinguent avec une grande précision la bvDFT de la maladie de Parkinson (98,3 %) et, combinées à un test cognitif simple, différencient également efficacement la MA, la bvDFT et Parkinson (Ibanez et al., 2021). Des profils d’atrophie cérébrale spécifiques ont été associés à ces performances. Nous continuons nos investigations de la cognition sociale dans les formes non comportementales, comme les variantes langagières ou motrices des DLFT.
SCANN : Social Cognition & Affective Neurosciences in Neurodegeneration
La cognition sociale est présenté comme un domaine prometteur pour distinguer la bvFTD des troubles psychiatriques d’apparition tardive, un défi clinique majeur. Plus de 50 % des patients atteints de bvFTD sont initialement diagnostiqués à tort avec un trouble psychiatrique, entraînant des retards importants dans l’orientation et le diagnostic — une tendance que nous avons confirmée dans notre réseau régional de consultations mémoire (Leroy, Bertoux et al., 2021).
Pour répondre à cette problématique, nous avons engagé un axe de recherche dédié, en comparant en profondeur la bvFTD à divers troubles psychiatriques tardifs. Après une première étude princeps comparant la bvFTD à la dépression majeure (Bertoux et al., 2012), nous avons récemment comparé la bvFTD au trouble bipolaire, en collaboration avec une équipe de Minas Gerais au Brésil. Les résultats indiquent que, quantitativement, les performances en cognition sociale ne permettent pas de distinguer ces deux groupes (Barbosa et al., 2023).
Ces résultats préliminaires ouvrent la voie à de nouveaux travaux visant à explorer de manière plus fine les différences cliniques, cognitives (avec des analyses qualitatives) et d’imagerie entre bvFTD et troubles psychiatriques d’apparition tardive. Ce programme de recherche constitue le cœur du travail de thèse d’Agnès Denève.
SOCIALIZE : du neurone à la société
Afin d’améliorer l’évaluation actuelle des dysfonctionnements interactifs, nous avons développé le projet SOCIALIZE, financé par la Fondation France Alzheimer et la Fondation Vaincre Alzheimer. Ce projet vise à développer et valider de nouveaux tests neuropsychologiques portant sur des capacités cognitives encore peu explorées, telles que la compréhension des normes sociales (et une éventuelle sur adhésion à celles-ci), la mémoire sociale, la construction de la confiance, la sémantique sociale et émotionnelle, ainsi que l’accès à la perspective d’autrui.
Nous incluons actuellement des patients atteints de formes comportementales ou sémantiques de DLFT, de maladie d’Alzheimer, ainsi que des participants contrôles au sein du CMRR du CHU de Lille. Nous recueillons à la fois les performances neuropsychologiques et les données d’imagerie, ce qui nous permettra de réaliser des analyses de corrélation neuro-anatomique. Le but de SOCIALIZE est de mieux comprendre ce qui détermine et module le comportement social, depuis les données anatomiques et fonctionnelles neurales jusqu’au notion de vulnérabilité sociale.
Dans un développement futur, nous souhaitons utiliser ces nouveaux tests dans un contexte psychiatrique, en évaluant des patients souffrant de troubles psychiatriques d’apparition tardive. Cela nous permettra d’estimer la précision diagnostique individuelle et combinée de ces mesures pour distinguer, par exemple, une DLFT d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble bipolaire.
SOCIAL-EYES : mesures digitales des interactions sociales
Extension du projet SOCIALIZE, nous développons actuellement des mesures comportementales subjectives et objectives, psychophysiques, incluant des marqueurs digitaux issus de l’oculométrie (eye-tracking), ainsi que des enregistrements visuels et vocaux, qui seront utilisés dans un cadre clinique dans le projet SOCIAL-EYES.
Nous explorerons spécifiquement le profil d’exploration visuelle des patients lors d’interactions sociales en situation réelle, ainsi que leurs réponses affectives. Des données de neuroimagerie, comprenant des séquences structurelles et fonctionnelles en état de repos, seront également acquises. Enfin, des questionnaires sociologiques permettront de recueillir des informations sur les déterminants sociaux de la santé, la vulnérabilité, l’isolement et la charge perçue.
Ce projet sera soutenu par l’Association Pulpy DFT.
Validation clinique française de tests internationaux
De plus en plus reconnue comme un domaine essentiel en santé mentale et dans les maladies du cerveau, la cognition sociale fait désormais l’objet de mesures utilisées pour quantifier les symptômes, évaluer les interventions thérapeutiques et orienter les diagnostics cliniques.
Notre équipe a initié, à travers plusieurs travaux essentiels, une réflexion en neurologie cognitive sur la place des variations culturelles dans la mesure clinique, en particulier dans les mesures de cognition sociale (Quesque et al., 2022 ; Fitipaldi et al., 2023).
Pour une évaluation neuropsychologique éthique, il est en effet rigoureusement important que chaque mesure clinique soit adaptée culturellement à la population à laquelle elle se destine.
Nous sommes partenaires d’équipes canadiennes (McGill) et américaines (UCSF) pour conduire la validation française de nouveaux tests d’évaluation de la cognition sociale, notamment de la reconnaissance émotionnelle et de la sincérité émotionnelle ainsi que de sémantique émotionnelle.
Harmonisation internationale
Dans un contexte scientifique marqué par une interconnexion croissante, les collaborations internationales se multiplient pour relever les défis mondiaux que représentent les troubles de la santé mentale. Ces initiatives (comme ENIGMA, le Human Brain Project, etc.) impliquent souvent le partage de données entre différents pays.
Notre équipe est donc partenaire ou actrice de plusieurs initiatives internationales visant l’harmonisation des mesures de cognition sociale, en Europe et ailleurs dans le monde, dans les consultations mémoires mais aussi les services de psychiatrie.
Dans l’ensemble, nous pensons que ces résultats sont essentiels pour faire progresser une compréhension éthique et mieux informée de la cognition sociale, ancrée dans une perspective mondiale plus inclusive. Par ailleurs, ces travaux ont le potentiel de renforcer les évaluations et les interventions en cognition sociale en prenant en compte la diversité culturelle.

Cet axe de recherche évalue l'impact de l'environnement physique et social sur la santé mentale.
Notre objectif est de déveloper des projets spécifiques sur la santé mentale des prisonniers pendant et après l'incarcération ainsi que sur l'influence des liens sociaux sur les trajectoires post-traumatiques.
SOCIO-TRAUMA
Projet porté par Wivine Blekic & Fabien D'Hondt
Ce projet de recherche s’inscrit dans une démarche participative, impliquant activement les personnes concernées à toutes les étapes du processus de recherche. Il vise à explorer l’impact des liens sociaux sur le développement du trouble de stress post-traumatique (TSPT) après un événement potentiellement traumatique, en tenant compte à la fois des savoirs scientifiques et des savoirs expérientiels issus du vécu des patients-partenaires. Cette collaboration permet de produire des connaissances applicables et adaptées aux réalités des individus touchés par le TSPT.
L’étude cherche à comprendre comment le soutien social perçu, la divulgation du traumatisme et les réactions de l’entourage influencent les trajectoires post-traumatiques. Grâce à une approche longitudinale sur un an, avec plusieurs temps de mesure, elle analysera l’évolution des réseaux sociaux et des symptômes
En parallèle, le projet intègre une réflexion sur la définition même d’un événement traumatique, en examinant les caractéristiques des situations rapportées et leur influence sur le développement du TSPT. Cette approche participative favorise une compréhension plus fine des facteurs sociaux impliqués, tout en identifiant des leviers d’intervention concrets pour améliorer la prévention et la prise en charge du trouble.
Contact : wivine.blekic@inserm.fr; fabien.d-hondt@univ-lille.fr
Santé mentale des femmes incarcérées en France
Projet de thèse de Marion Eck, sous la co-direction du Pr. Pierre Thomas et du Dr. Thomas Fovet
Depuis plusieurs décennies, les travaux de recherche épidémiologiques internationaux montrent systématiquement des prévalences élevées pour les troubles psychiatriques en milieu pénitentiaire. Tous les troubles psychiatriques sont surreprésentés en milieu carcéral par rapport au milieu libre, avec un niveau de preuve particulièrement important pour l’épisode dépressif caractérisé, les troubles psychotiques, le trouble de stress post-traumatique et les troubles de l’usage de substances. Les pathologies duelles, définies comme la co-occurence de troubles psychiatriques sévères et de troubles de l’usage de substances, sont également fréquentes en milieu pénitentiaire. Les décès par suicide sont associés à un trouble psychiatriques dans plus de la moitié des cas, et les personnes détenues présentant un trouble psychiatrique sont plus à risque de mortalité à la libération et plus à risque de réincarcérations. La santé mentale des personnes détenues constitue ainsi un problème majeur de santé publique.
En France, les études ayant mesuré la prévalence des troubles psychiatriques en prison sont rares et aucun état des lieux exhaustif des connaissances scientifiques sur le sujet n’a jamais été mené. La première étape de notre travail consiste donc en la réalisation d’une revue systématique de la littérature portant sur la prévalence des troubles psychiatriques dans les prisons françaises.
Suite à cet état des lieux, l’objectif de notre travail est de réaliser une nouvelle mesure de la prévalence des troubles psychiatriques dans les prisons françaises, d’apprécier leur évolution au fil de l’incarcération, et d’en identifier les facteurs associés. Cette thèse s’appuie sur deux études épidémiologiques :
- L’étude transversale "Santé en Population Carcérale Sortante" (SPCS), et plus précisément son volet « population carcérale féminine » (SPCS-f), menée entre 2021 et 2022 dans la région des Hauts-de-France auprès d’un échantillon de 127 femmes incarcérées en fin de peine ;
- L’étude longitudinale « Epidémiologie Psychiatrique Longitudinale en Prison » (EPSYLON), démarrée en janvier 2024 et en cours de réalisation, menée au niveau national auprès d’environ 800 hommes et 200 femmes incarcérés évalués à 3 reprises au cours des 9 premiers mois d’incarcération.
Le choix de la sous-population, des variables d’intérêt, et des analyses secondaires sont guidés par les résultats de la revue de la littérature, dans l’objectif de combler les lacunes de la littérature actuelle à ce sujet.
L’enjeu de ce travail est important. Au-delà de l’actualisation des données épidémiologiques, il permettra de guider les politiques de prévention et de prise en charge des troubles psychiatriques chez les personnes détenues en France.

